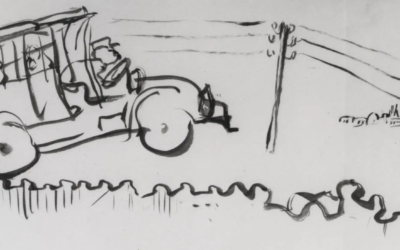Perspectives sadiennes dans Le Jardin des supplices
Avec Octave Mirbeau, nous entrons de plain-pied dans le domaine du sacré profanatoire, entendu au sens bataillien, c’est-à-dire sacré de transgression. Il ne s’agit pas d’un quelconque sentiment religieux à l’égard d’une divinité, même si l’auteur passera sa vie à fustiger les valeurs morales de son temps – n’est-ce pas là les prémices d’un retour au culte dyonisiaque, au chaos ? – mais plutôt la volonté exacerbée de dénoncer les abus sociaux, la corruption, le vol, l’hégémonie de l’État et l’indifférence des « têtes de veaux », gens ordinaires que plus rien n’étonne. Mirbeau, un anarchiste inspiré ? En tout cas, Pierre Michel affirme que « sa colère, sa violence et ses injures sont nées de la même source que la malédiction des prophètes »i. Le Jardin des Supplices en est sans doute la plus parfaite illustration : le paysage sanglant et torturé du Bagne de Canton n’est finalement que l’envers de notre société. La richesse des thèmes et des références abordés, la complexe structure textuelle de l’ouvrage – cette « monstruosité » littéraire comme la définissent parfois certains critiques – en font sans doute l’une des figures emblématiques du décadentisme. Comment ne pas songer au travers d’une peinture esthétisante des supplices, au Saint-Julien l’Hospitalier de Flaubert, à La Morte amoureuse de Gautier, aux contemplations horrifiées de Huysmans et de Baudelaire, à Villiers de l’Isle-Adam, à Lautréamont enfin ? Si la lecture du Jardin des Supplices est plurielle, c’est peut-être avec l’œuvre sadienne que l’adéquation semble la plus frappante.
D’aucuns diront que les enjeux des deux auteurs sont bien éloignés l’un de l’autre d’un point de vue philosophique ou social, il n’en reste pas moins que l’on rencontre des ressemblances troublantes si l’on s’intéresse aux thèmes développés, au fonctionnement textuel ou aux principes argumentatifs régissant chaque œuvre. Avant tout, il paraît intéressant de comprendre en quoi Mirbeau crée une sorte de nouveau langage lorsqu’il compose Le Jardin des Supplices, à l’instar du Marquis de Sade des Cent vingt journées de Sodome. L’analyse de Barthesi(1) définit quatre opérations nécessaires à la production d’un langage propre. La première est de s’isoler, c’est à dire de créer une séparation, un vide matériel aussi bien géographique que temporel. Sade enferme ses libertins dans le château de Silling(3), lieu inviolable qui se situe en haut d’une montagne accessible uniquement à pied en « cinq grosses heures ». Pour l’atteindre, il n’existe qu’un chemin dont le pont indispensable a été détruit et qui traverse une forêt noire. Arrivé au pied de l’enceinte, l’on se retrouve face à des murs « de plus de trente toises ». Autrement dit, le lieu sadien est totalement impénétrable et purement imaginaire. Que dire du Jardin des Supplices ? La génèse du roman vient se situer à l’intérieur d’un salon fréquenté par des intellectuels de différentes couches culturelles, érigeant par là-même un espace confiné et hermétique réservé à la seule élite – aux élus ?. Puis le récit se poursuit sur le bateau qui mène à Canton, espace clos où discutent des individus souvent masculins, de toute espèce et qui semblent ne devoir exister que par leur discours provocateur, leur laideur morale et leur vanité débordante. Atmosphère irréelle à laquelle vient s’ajouter « une chaleur écrasante… une température de flamme… »(4), annonciatrice des enfers. Le Bagne de Canton enfin, est une forteresse imprenable, entourée de « tours carrées » sans fenêtre et dont la seule issue est « une immense porte, armée de lourdes barres de fer »(5). L’intérieur même du jardin est une succession d’espaces clos et circulaires : « Nous laissâmes l’allée circulaire sur laquelle s’embranchent d’autres allées sinuant vers le centre »(6). En outre, la théâtralité du jardin répond à une hiérarchie spatiale des tortures. Tout comme la descente des cercles dans L’Enfer de Dante ou la répartition en chœurs des différents tableaux sadiens, figurant de plus infernales damnations, la pénétration progressive au centre du jardin mène peu à peu à de plus cruelles tortures.
La seconde opération indispensable est d’articuler, c’est-à-dire de diviser les séquences, de les distribuer et de les assembler autour d’une combinatoire. Sade distribue la jouissance, Mirbeau les supplices. L’un morcelle le plaisir en « postures », « figures » ou « séances » ; l’autre découpe la souffrance selon des principes de Beauté. Tout acte, qui aboutit inéluctablement à la mort, provient de la Parole. Il n’est rien d’indicible, « rien n’est qui ne soit parlé »(7). À l’image des historiennes de Sade qui sont là pour recenser de façon systématique l’ensemble des « crimes » commis par l’humanité,
Clara existe pour dénombrer de plus horribles tortures. Chez les deux écrivains, cette classification croissante de l’horreur conduit toujours à de formidables jouissances. Les libertins du château se retirent dans leurs boudoirs, Clara exulte en des lieux éloignés et secrets du jardin. Se substituant à la parole divine – « Au commencement était le Verbe… » –, les deux auteurs font exister les actes par le discours qu’ils confèrent aux différents narrateurs. Dès lors, il semble que l’œuvre sadienne comme l’œuvre mirbellienne naisse de la seule imagination. Chez Sade, seul le maître, le libertin, a la parole – autrement dit, les grands criminels. Chez Mirbeau, seuls s’expriment les personnages amoraux, les « monstruosités », comme il les nomme : Clara, son ami, le bourreau… Il y a donc bien une volonté commune d’articuler l’ordre social, la réalité, autour d’un système purement verbal dépendant finalement du narrateur, et donc de l’imaginaire de l’écrivain. Rappelons que ce procédé est très souvent utilisé par Mirbeau : le narrateur, s’érigeant en conscience collective, force le lecteur à réagir dans la mesure où l’écriture proposée joue sur l’apparente dérision, la provocation, l’excès du propos. Et c’est peut-être ici que les deux écrivains se séparent. Si Sade instaure un univers totalement imaginaire, verbal, pour mieux
se détacher d’une réalité qui le persécute et l’ennuie, Mirbeau, lui, utilise ce processus créatif pour mieux asseoir son autorité contre la société et la forcer à réagir.
La troisième opération est d’ordonner. Il devient non seulement nécessaire d’assembler des séquences entre elles, mais aussi de les soumettre à un ordre supérieur. Le discours est soumis à un ordonnateur. Comme nous l’avons déjà signalé, chez Sade, il s’agit du maître de cérémonie. Libertin quelconque, il est chargé de mettre en place, à un moment donné, les postures et de diriger la marche générale de l’opération érotique ; il y a toujours quelqu’un pour régler les tableaux. Tout est absolument orchestré dans le temps et il ne s’agit en aucun cas d’y déroger – l’opération paraît d’ailleurs impossible – puisque le temps dépend de la parole. Sade tente d’instaurer de cette manière une harmonie dans le désordre. Si la volonté d’harmonisation sociale est relativement différente du modèle sadien chez Mirbeau, il est clair que la fonction du Bagne a un rôle éminemment unificateur. René Girard affirme que « le dénominateur commun aux sacrifices rituels, c’est la violence intestine, les dissensions, les rivalités, les jalousies, les querelles entre proches que le sacrifice prétend éliminer »(8). Le système pénal du bagne illustre assez bien cette analyse : les tortures les plus horribles ne correspondent aucunement à l’importance des délits commis par les suppliciés. Ainsi, lorsque le narrateur demande à Clara les raisons
pour lesquelles ces individus subissent de tels supplices, elle lui répond : « Je ne sais pas moi… aucune peut-être, ou peu de choses, sans doute… de menus vols chez des marchands »(9). Il s’agit moins, à travers les martyres humains, de punir, de sanctionner un délit, que de renforcer l’harmonie de la communauté, d’assurer l’unité sociale. Au moyen du sacrifice institutionnalisé, l’État canalise et discipline la violence qui, si elle était libérée, conduirait au désastre. La cruauté des lois asiatiques répond à un rituel cyclique, où l’individu n’a de raison d’être que dans son appartenance à un défoulement collectif. Dans le livre de Chu Yü, l’on affirme que les sacrifices, la musique, les châtiments et les lois ont une seule et même fonction, qui est d’unir les cœurs et d’établir l’ordre. C’est bien dans une même union des cœurs et une même joie frénétique que les individus se précipitent à l’entrée du bagne : « Je vis des robes et des robes, et des ombrelles, et des visages maudits danser, tourbillonner, se précipiter »(10). Notons ici l’attitude passablement misogyne de l’auteur à l’égard de ces femmes endiablées. La communauté chinoise participe donc tout entière à cette orgie furieuse, et la brutalité des sacrifices agit comme une catharsis. Au sortir du bagne, les visiteurs sont rassasiés d’horreur et de cruauté, et de cette manière s’effacent les dissensions qui auraient pu naître pour laisser place au contraire à une plus grande unité sociale. On retrouve cette unité sociale dans l’univers sadien ; cependant elle n’est plus supportée par un ensemble de mécanismes exutoires, mais par une hiérarchie totalitaire et une mise en scène extrême.
La quatrième opération, qui réside en une théâtralisation du discours, renvoie naturellement à cette nécessité. Comme Barthes l’explique, Sade « classificateur » utilise un style insistant, il élabore une « opération de pesée et de poussée »xi qui conduit à édifier son système en systématique. Chez Sade, cette insistance est concrétisée par le « foutre » : « Toutes les immoralités s’enchaînent et plus on en réunira à l’immoralité du foutre, plus on se rendra nécessairement heureux »xii, c’est-à-dire vivant. Chez Mirbeau, et particulièrement dans Le Jardin des Supplices, il semble que ce soit « le sang » et « la pourriture » qui tiennent lieu de principe organisateur – Barthes parle de « métonymie centrée ». En effet,
toute action humaine, toute réalisation de la vie, est inextricablement liée au principe régénérateur de la putréfaction. Le sacrifice, médiateur entre la vie et la mort chez Mirbeau s’érige progressivement en Loi universelle dans le monde torturé du Jardin des Supplices. Le sacrifice est nécessaire dans la mesure où il assure le renouvellement de la vie. Clara s’écrie : « La pourriture, c’est l’éternelle résurrection de la vie »(13). En d’autres termes, la Beauté naît nécessairement du sacrifice, et l’auteur élabore ici une conception naturaliste de l’univers. Instruments de torture et paysages édéniques sont liés dans le jardin : de place en place, simulant des salles de verdure et des parterres de fleurs, tout un outillage de sacrifice et de torture, étalait du sang. La beauté de la vie paraît étrangement faire corps avec l’horreur de la mort. Ainsi, la répétition constante de thèmes fondateurs permet à l’œuvre de se théâtraliser, c’est-à-dire « d’illimiter le langage », de se mettre en
scène en inaugurant un dépaysement moral permanent et en inversant radicalement nos vieilles valeurs morales, ce qui nous rapproche largement des valeurs décadentes inaugurées par Huysmans ou Barbey d’Aurevilly. Bien plus, ce qui est dénoncé par Mirbeau et Sade, c’est tout à la fois la corruption intestine, le vol généralisé et le despotisme institutionnel.
Le Jardin des Supplices débute au cours d’un repas entre intellectuels – la nourriture a peut-être cette même fonction sadienne qui est de restaurer les appétits sexuels et criminels –, « des moralistes, des poètes, des philosophes, des médecins… » « qui disputaient sur le meurtre… » L’un des protagonistes va même jusqu’à affirmer que « le meurtre est la plus grande préoccupation humaine, et que tous nos actes dérivent de lui »(14). Et plus loin un philosophe ajoute : « Il est exorbitant que, sous prétexte de gouverner les hommes, les sociétés se soient arrogé le droit exclusif de les tuer, au détriment des individualités en qui, seules, ce droit réside »(15). Sade n’affirme rien d’autre lorsqu’il oppose, dans son Français, encore un effort…, « l’absurde despotisme politique » et « le très luxurieux despotisme des passions de libertinage » ; et de là l’apparente contradiction entre les crimes de l’État et ceux des individus, entre la peine de mort et le meurtre individuel. Toute l’œuvre sadienne va à l’encontre de cette opposition et celle-ci prend appui sur l’affirmation du goût naturel et irrésistible de toute l’humanité pour le meurtre et le despotisme, et sur la nécessité de trouver à ce goût quelque issue qui ne soit pas trop néfaste à la société. Mirbeau quant à lui montre clairement que « le meurtre est une fonction normale de la nature et de tout être vivant »(16) et qu’il est nécessaire pour le bon fonctionnement de la société d’instaurer des divertissements qui puissent assouvir cette soif de sang. De la sorte, les foires où se multiplient les stands de tir ont essentiellement la vertu de satisfaire « la sensation exquise de penser que l’on va tuer des choses qui bougent, qui avancent, qui implorent !… ». Acte proprement sadien de par sa jubilation au spectacle de la souffrance d’autrui, il trouve aussi son pendant dans les classes aisées de la société sous l’apparence policée des duels, de l’escrime et de la chasse. Ces activités ont pour unique fonction de libérer la violence contenue dans l’homme. Lorsque sur le bateau, l’un des personnages exprime la jouissance qu’il a de tuer des animaux – notons ici la correspondance avec Saint-Julien l’Hospitalier –, il exprime du même coup le sentiment inavoué de transgresser l’interdit : « Tu ne tueras point ». « Je m’arrêtais au bord de la forêt, et j’accrochais la cage au bout d’une branche, le coq chantait… Alors de toutes les profondeurs du bois les poules venaient… venaient… elles venaient par bandes innombrables… Et je les tuais !… J’en ai
tué jusqu’à douze cents dans la même journée »(17). La chasse ne répond nullement à l’instinct de survie. C’est au contraire la joie profonde de détruire qui est valorisée, une violence libératrice dont l’homme est privé ordinairement. Ce que dénoncent finalement les deux auteurs, c’est le fonctionnement double du système social. Ce dernier est à la fois préventif – mise en place de plaisirs sublimés : chasse, tir au fusil –, et curatif : un individu qui déroge à la loi est irrémédiablement puni, la peine de mort étant la sanction ultime. Or la peine capitale est un « droit exclusif » que se sont attribué les sociétés, dit Mirbeau, ce qui prouve l’iniquité d’un tel système. Sade propose deux bonnes raisons d’abolir la peine de mort. D’une part, « il est impossible que la loi puisse obtenir le même privilège… car elle n’est pas accessible aux passions qui peuvent légitimer dans l’homme la cruelle action du meurtre ». D’autre part, « la peine de mort n’a jamais réprimé le crime, puisqu’on le commet chaque jour aux pieds des échafauds »(18). Dès lors, Mirbeau se détache du raisonnement sadien dans la mesure où il ne justifie en rien l’acte criminel ; il se contente simplement d’un constat effrayé et voit dans la guerre le stade ultime de la barbarie humaine. En témoigne l’extase jubilatoire du militaire qui déclare : « C’est par la guerre, c’est-à-dire par le vol, le pillage et le massacre, que nous entendons gouverner »(19). La guerre est là encore sacré de transgression puisqu’elle est la promesse d’une véritable apocalypse, d’un temps où tout serait permis, où tout acte autrefois réprimandé et réputé abominable apporterait aujourd’hui gloire et prestige : « Il trouvera, dans la guerre, la suprême synthèse de l’éternelle et universelle folie du meurtre… qui est une fonction nationale »(20)x. De son côté, Sade poursuit son raisonnement et aboutit à l’éloge du despotisme privé et de ses pratiques et à la condamnation du despotisme d’Etat et de son système judiciaire.
Les écrivains se rejoignent en ce qu’ils voient tous les deux une part pulsionnelle au fonctionnement étatique. Ainsi, Pasolini voit dans le texte sadien un idéal d’anarchie. Que les personnages s’adonnent à leur lubricité meurtrière ou aux affaires d’État, il s’agit toujours d’assurer la puissance aux grands de la société. Ce que récuse la version filmée des Cent vingt journées de Sodome, c’est le lien entre anarchie et hégémonie totalitaire qui règle la loi sociale : « Les gens qui nous gouvernent semblent représenter l’ordre, la légalité, les lois et les codes alors qu’au contraire, ils dirigent de façon arbitraire ; ils exercent l’exploitation de l’homme par l’homme »(21). La peinture sadienne montre un enchevêtrement indescriptible dans les rapports entre la collectivité et les personnes, le despotisme, l’anarchie, l’arbitraire et la loi qui ne les prévient pas ou les favorise. Mirbeau montre lui aussi, de façon détournée, l’illégitimité du fonctionnement social : « Au nom de quel droit la société va-t-elle condamner des assassins qui n’ont fait, en réalité, que se conformer aux lois homicides qu’elle édicte, et suivre les exemples sanglants qu’elle leur donne ?… »(22). Chez Mirbeau comme chez Sade, on découvre derrière ce téléscopage des pulsions individuelles et du despotisme public, une inébranlable volonté de puissance. Mais le Marquis semble appuyer son idée sur une logique spécieuse de la preuve par la nature, tandis que le second utilise ce procédé pour la seule fin de contrebalancer l’image de la société occidentale. L’un et l’autre laissent leurs personnages discourir sur la nécessité d’une inégalité entre les individus au nom d’une inégalité naturelle posée en principe, même si le propos reconnaît parfois l’avantage du rang et de la richesse. Mirbeau se borne à un constat et le dédie « Aux prêtres, aux soldats, aux juges, aux hommes qui éduquent, dirigent et gouvernent les hommes ». Sade justifie son modèle en affirmant que cette tendance au despotisme est non seulement innée, mais incontournable : « Tous les hommes tendent au despotisme ; c’est le premier désir que nous inspire la nature… ». Une telle réflexion révèle chez les deux auteurs la volonté de balayer la thèse rousseauiste qui fait de l’Homme un être bon par nature, et dévoile en filigrane un fonctionnement sexiste du système, où l’homme semble plus apte à dominer. Seuls les intellectuels ont le droit de parole, exceptées Clara ou Juliette qui exercent leur volonté de puissance aux dépens des hommes socialement inférieurs à elles – prisonniers, hommes de compagnies, valets… Ce qu’éclairent là encore Sade et Mirbeau, c’est une hiérarchie – ici des sexes – fondée sur un fait de nature, et non sur un accord tacite des différents intéressés. Pourtant, nous aurions tort de voir dans cette mise à jour des inégalités sociales et/ou naturelles, un idéal de liberté ; l’un s’en tient à une attitude philosophique de l’Homme, l’autre à un discours politique des individus.
En outre, il serait possible de développer les valeurs décadentes attribuées aux visages féminins – thème si cher au Divin Marquis –, le personnage de Clara faisant peut-être office de référence. Cette femme vampirisée ne ressemble-t-elle pas au Convive des dernières fêtes de Villiers de l’Isle-Adam(23), écrivain fasciné par les exécutions en Extrême-Orient ? Ou encore, n’est-ce pas la même jouissance qu’éprouvent Clara à jeter de la viande pourrie aux prisonniers et Baudelaire à contempler le combat impitoyable des enfants lorsqu’il leur jette un morceau de pain blanc ?(24). Auteur qui parle dans « Voyage » du « Bourreau qui jouit » et « du martyr qui sanglote »(25). Perspectives éminemment sadiennes qui consistent à jouir de la souffrance d’autrui et qui conduisent Mirbeau vers une contemplation horrifiée des monstres moraux. Ses peintures n’ont rien à envier à celles de Sade lorsqu’il fait avouer de façon perverse au bourreau asiatique : « D’un homme j’ai fait une femme… Hé ! Hé ! Hé !… C’était à s’y méprendre… Et je m’y suis mépris pour voir… »(26). C’est avec cette même délectation sadique qu’il décrira plus loin le supplice du rat. À travers le regard obsédé de l’Anglaise, l’on pénètre dans l’univers du plaisir morcelé, du corps désarticulé, où à chaque organe correspond une zone érogène. L’intérieur du jardin mêle confusément engins de torture, membres mutilés et luxuriance végétale : « De place en place, dans les renfoncements de la palissade, simulant des salles de verdure et des parterres de fleurs… tout un outillage de sacrifice et de torture, étalait du sang… »(27). Le bouillonnement érotique, l’assourdissement sacrificiel, semblent complets en ce lieu de débauche paroxystique et fait écho aux plaisirs sadiens de L’Histoire de Juliette : « Tout agissait, tout bandait, tout se prêtait. On n’entendait que des cris ou de plaisirs ou de douleur, et le murmure délicieux des cinglons de verge ». Clara, mue par ses instincts, ses pulsions destructrices – catalysant ainsi toutes les tendances misogynes du moment – ne représente pas seulement la fuite de l’esprit bourgeois conformiste, hypocrite et corrompu, comme l’ont pu voir certains critiques. La confusion qui s’exerce au travers de son regard entre l’Amour et la Mort confère à l’érotisme, une fonction médiatrice. « L’amour et la mort c’est la même chose » s’exclame-t-elle. C’est que dans l’instant fugitif de l’orgasme, le couple rompt l’abîme qui les séparait, ce que Bataille appelle « la discontinuité de l’être » et qu’il définit comme « approbation de la vie jusque dans la mort »(28). Sade est bien proche de la réflexion de Clara lorsqu’il avoue : « Il n’est pas de meilleur moyen de se familiariser avec la mort que de l’associer à une idée libertine »(29). Dès lors, l’écrivain attribue à ses personnages féminins une place déterminante lorsqu’il allie « tableau » érotique et « crime ». Si la femme est sans caractère, sans pouvoir, sans phallus, elle est aussi motivée par la violence pulsionnelle et sert en ce sens la cruauté du bourreau et devient un symbole de « souillure ». Elle devient le médiateur nécessaire à l’abolition du « dégoût » et, du même coup, la dénégation du compromis social. En allant au delà du « dégoût », le sujet fait « triompher sa libido sur l’interdit »(30). Une telle analyse met l’accent sur le franchissement d’une frontière et fait fonction d’exorcisme. Retournant le dégoût en désir, l’écriture fait de l’acte érotique une transgression sexuelle et symboliquement sociale.
Conclure sur les rapports qu’entretiennent Sade et Mirbeau est une opération difficile tant le sujet semble vaste et encore peu exploré. Les correspondances sont nombreuses : sacrifice perçu comme source de plaisir et de renouvellement, où souffrance et volupté sont les liens essentiels de la vie et de la mort, dénonciation des valeurs morales, du despotisme étatique, représentation misogyne de la femme. Et si l’un et l’autre sont encore aujourd’hui des écrivains peu lus – voire rejetés –, c’est qu’ils expriment tous les deux l’idée d’un Mal universel, d’une Beauté achetée au prix de la douleur. L’un prend l’allure d’un prophète qui transgresse et démystifie les valeurs sacrées de son époque – « son seul crime, c’est d’avoir mis la société en face d’elle-même » dit Pierre Quillard ; l’autre se fait mystificateur aux yeux de la critique – ni Bataille, ni Blanchot, ni Beauvoir ni même Klossowski ne sont d’accord quant à savoir quelles valeurs attribuer à ses écrits. Les deux auteurs prônent peut être un individualisme émancipé des contraintes et des limites humaines. Non pas un individualisme anarchisant, comme certains les ont souvent taxés, mais un individualisme qui place le bonheur personnel en valeur absolue et qui réside dans la satisfaction des désirs. Tous deux libérateurs de par leur insolence, leur destruction
des idoles et des faux-semblants, ils imposent au lecteur de rechercher une juste distance, entre rejet et identification.
Jérôme GOUYETTE pour le compte de la S.O.M.
(1) O. Mirbeau, l’imprécateur au cœur fidèle. p. 12. P. Michel et J. F. Nivet. Séguier. 1990.
(2) Sade, Fourier, Loyola. R. Barthes. Points/Seuils. 1970.
(3) Les Cent vingt journées de Sodome. DAF Sade. Pauvert. 1990.
(4) Le Jardin des Supplices. pp.99.100. O. Mirbeau. 10/18. 1986.
(5) Ibid. p. 159.
(6) Ibid. p. 233.
(7) Op. cit. p. 9.
(8) La Violence et le sacré. R. Girard. Grasset. 1974.
(9) Op. cit. p. 174.
(10) Op. cit. p. 166.
(11) Op. cit. p. 11.
(12) La Philosophie dans le boudoir. Folio. 1991.
(13) Op. cit. p. 162.
(14) Op.cit. p. 21.
(15) Ibid. pp. 24. 25.
(16) Ibid. p. 24.
(17) Ibid. p. 97.
(18) Op. cit. p. 209.
(19) Op. cit. p. 115.
(20) Ibid. p. 32.
(21) Quinzaine littéraire. p. 10. « Entretien avec Pasolini » 1984.
(22) Op. cit. p. 33.
(23) Contes cruels. Villiers de l’Isle-Adam. Folio. 1991.
(24) Le Gâteau. C. Baudelaire. La Pléiade. 1975.
(25) Ibid. p. 132.
(26) Op. cit. p. 209.
(27) Ibid. 235.
(28) L’Érotisme. G. Bataille. Ed. de Minuit. 1985.
(29) Op. cit. p. 18.
(30) Bouche dégoût. p. 79. F. Péraldi. Traverses 37. 1986.
Le jardin des supplices (1899)
Ce roman, publié en 1899, au plus fort de l’affaire Dreyfus, à la veille du procès d’Alfred Dreyfus à Rennes, est le point d’orgue d’un long combat contre la société capitaliste. Le Jardin des supplices est d’abord un texte de combat dont les trois parties…
Dingo (1913)
La fable, illustrant les apories du naturisme, fait bon ménage avec la caricature, et les plus burlesques hénaurmités ont droit de cité. De nouveau, ce n’est pas un homme qui est le héros du “roman”, mais le propre chien de Mirbeau, Dingo …
La 628-E8 (1907)
Dédiée à Fernand Charron, le constructeur de l’automobile « Charron 628-E8 », cette œuvre inclassable n’est ni un véritable roman, ni un reportage, ni même un récit de voyage digne de ce nom, dans la mesure où le romancier-narrateur n’a aucune prétention à la vérité…
Les 21 jours d’un neurasthénique (1901)
Comme Le Jardin des supplices, ce volume résulte d’un bricolage de textes : Mirbeau juxtapose quelque 55 contes cruels parus dans la presse entre 1887 et 1901, sans se soucier de camoufler les…
Le journal d’une femme de chambre (1900)
La première mouture du roman a paru en feuilleton dans L’Écho de Paris, du 20 octobre 1891 au 26 avril 1892. Mirbeau traverse alors une grave crise morale et conjugale, se sent frappé d’impuissance…
Dans le ciel (1892)
Dans le ciel est un roman paru en feuilleton dans les colonnes de L’Écho de Paris du 20 septembre 1892 au 2 mai 1893 et qui n’a été publié en volume qu’en 1989, aux Éditions de l’Échoppe, Caen,…